Critique23. März 2025 Cineman Redaktion 3w5e2e
Critique de «Reine Mère», un roi marteau pour ami i6r40

Les temps sont durs pour Amel et sa famille, sur le point de se faire expulser de leur appartement. La jeune femme tient à rester dans le même quartier huppé, mais refuse de chercher un travail. Son existence prend une tournure fantastique le jour où Charles Martel débarque dans la vie de sa fille Mouna.
Amel (Camélia Jordana) est tunisienne ; son mari Amor (Sofiane Zermani) est Algérien, et leur fille aînée, Mouna (Rim Monfort), est la seule élève à consonance étrangère dans la classe de son école catholique. Marginalisée par ses origines, la famille se retrouve dans une situation critique le jour où elle doit libérer son appartement. Sans diplômes, Amel refuse corps et âme de changer de quartier et s’oppose à chercher un travail qu’elle juge être une basse besogne. Un jour, lors d’un cours d’histoire sur la bataille de Poitiers, Charles Martel (Damien Bonnard), resté dans les annales pour avoir repoussé avec énergie les Arabes en 732, sort de l’écran, devenant un ami imaginaire pour Mouna, seule à le voir.
Traverser l’écran est une lubie qui, parfois, peut prendre les personnages: ainsi en était-il par exemple dans «La Rose Pourpre du Caire», film de Woody Allen sorti en 1985. Face à Mouna, c’est d’une diapositive – nous sommes en 1984 – que sort un jour Charles Martel, duc des Francs que l’histoire a retenu comme étant celui qui a «écrasé les Arabes» avec l’élan d’un martel, forme ancienne de marteau. Sur fond de guerre du Golfe et d’allocutions de Bush senior à la TV, l’anecdote, récupérée par la droite et convertie en mythe, a longtemps symbolisé la bataille des chrétiens contre l’islam. Or, comme le rectifiera plus tard l’histoire, et Mouna elle-même dans un exposé, il s’agissait de Berbères, parmi lesquels tous n’étaient pas musulmans.
En format panoramique sur un écran large, la caméra se fait discrète, laissant tout loisir aux personnages d’occuper l’espace et de s’y déplacer dans des gammes de couleurs saturées. Ceux que filme Manele Labidi, réalisatrice franco-tunisienne dont «Reine Mère» est le 3e opus, sont des héros du quotidien: à des années-lumière de l’esprit revendicateur du 21e siècle, la discrimination à laquelle fait face la famille est un élément presque comme un autre de leur existence. Laisser la parole à ses personnages, et le champ libre à Charles Martel, en particulier, de raconter sa propre version de l’histoire, c’est un peu pour la réalisatrice un moyen de changer notre regard sur les événements du é et de reconquérir une identité malmenée.
Si le mélange des genres peut paraître surprenant au premier abord, il permet d’insuffler un petit vent de lyrisme magique dans une narration qui tient bon la route. Lors d’une scène en noir et blanc, Amel se retrouve à faire des claquettes avec un Charles Martel en queue-de-pie, et quand un énième propriétaire, suspicieux devant le nom de famille des époux, leur demande si leur nom est d’origine italienne, Amor, le mari, lui déclame sa réponse dans une expression lyrique en italien. Dans le rôle de Mouna, la jeune Rim Monfort pose son personnage avec justesse, mature sans faire adulte et expressive sans s’époumoner. Chaleureux et proche de ses personnages, le film pose un regard réfléchi sur une problématique qui n’a pas fini de nous occuper.
Au cinéma depuis le 19 mars.
Plus d’informations sur «Reine Mère»
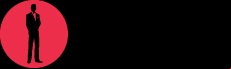













Vous devez vous identifier pour déposer vos commentaires.
& Enregistrement